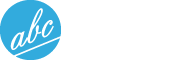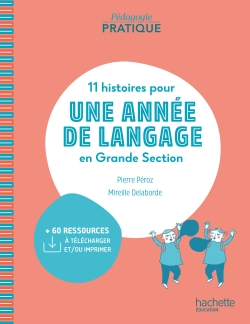
Avant de découvrir la pédagogie de l’écoute, mes moments de langage ressemblaient à une suite de questions-réponses : je posais une question, un élève répondait, je validais ou corrigeais, puis je posais une autre question.
Dans ce modèle, seuls les élèves les plus à l’aise s’exprimaient. Les autres restaient spectateurs. Et je ne m’en rendais même plus compte.
Avec les travaux de Pierre Péroz, maître de conférences en sciences du langage à l’INSPÉ de Lorraine, j’ai repensé en profondeur la place du langage dans mes séances. Sa pédagogie de l’écoute a pour objectif de faire parler tous les élèves, en créant un climat d’écoute active, sans jugement immédiat, où la répétition est permise, voire valorisée.
📚 Vous pouvez commander les livres de Pierre Péroz :
👉 11 histoires pour une année de langage en petite section
👉 11 histoires pour une année de langage en moyenne section
👉 11 histoires pour une année de langage en grande section
Liens partenaires – prix identiques
SOMMAIRE :
A. La pédagogie de l’écoute libère la parole pour tous les élèvesB. Le format type d’une séance selon Pierre Péroz dans la pédagogie de l'écoute
C. Ce que la pédagogie de l'écoute m'a appris
D. La pédagogie de l'écoute est transversale
E. Adapter la pédagogie de l'écoute aux contraintes de la classe
F. Aller plus loin
La pédagogie de l’écoute libère la parole pour tous les élèves
La pédagogie de l’écoute repose sur un principe simple : faire de la parole un droit pour tous, pas un privilège pour quelques-uns. Cela suppose plusieurs ruptures majeures dans nos habitudes :
- Accepter les répétitions : un élève a le droit de redire ce qu’un autre a déjà exprimé. Ce droit à la redite sécurise la prise de parole.
- Reporter l’évaluation : l’enseignant n’intervient pas entre chaque réponse. Il laisse les élèves enchaîner leurs prises de parole avant de reprendre la main.
- Structurer les échanges : le questionnement est ritualisé et annoncé. Il suit toujours une même trame.
Ce changement de posture transforme la dynamique de classe. Ce ne sont plus les 4 ou 5 mêmes élèves qui lèvent la main pour parler. C'est l'ensemble des élèves, y compris les plus réservés.
Le format type d’une séance selon Pierre Péroz dans la pédagogie de l'écoute
Voici la trame recommandée par Pierre Péroz dans ses ouvrages et conférences, que j’ai adoptée rapidement :
- Lire ou raconter une histoire sans montrer les images, pour créer des images mentales et éviter la lecture d'image.
- Phase de langage oral, en petits groupes ou demi-classe, selon ce schéma constant :
- "De quoi vous souvenez-vous ?"
- "Quels sont les personnages ?"
- Questions sur les états mentaux des personnages type : "Pourquoi Amélie est-elle en colère ?"
- Hypothèses sur la suite de l'histoire type : "à votre avis, que va faire la maîtresse avec le monstre ?"
L’enseignant laisse la parole circuler. Il écoute, note s'il le peut, mais ne commente pas chaque réponse. Il distribue la parole. Il explique et répète : "on a le droit de répéter ce que les copains ont déjà dit".
Des effets visibles dès les premières séances
Lors de mes premiers tests en classe avec des élèves de grande section, j’ai vu des élèves d’ordinaire très discrets oser prendre la parole. Certains répétaient simplement ce qui avait déjà été dit, mais souvent en ajoutant un petit détail. D’autres construisaient une phrase plus longue que d'habitude. Tous semblaient écouter avec plus d’attention, comme s’ils comprenaient qu’ils auraient, eux aussi, un rôle à jouer.
Les résultats ne sont pas immédiats dès la première séance. Certains élèves ont besoin d'observer, d'être rassurés que cette règle, répéter ce qui a déjà été dit, sera toujours la même. Souvent, au bout de 2 ou 3 séances, tous les élèves ou presque ont osé prendre la parole.
Au début, chaque prise de parole est récompensée par un jeton ou un cube. En fin de séance, je fais le bilan : Alexandre, tu as 3 cubes, tu as parlé 3 fois, je le note sur ma fiche, bravo ! Noé, je vois que tu n'as pas de cube aujourd'hui. La prochaine fois, tu pourras lever la main, tu as le droit de répéter ce que les autres ont dit. Si Noé ne prend pas la parole lors de la seconde séance, je suis à peu près certain qu'il prendra la parole lors de la troisième séance.
La permanence de cette règle modifie le climat des séances. Les élèves sont plus attentifs et à l'écoute : en écoutant, ils comprennent qu'ils peuvent prendre la parole par la suite.
Ce que la pédagogie de l'écoute m'a appris
Adopter la pédagogie de l’écoute, c’est accepter de renoncer à tout contrôler. C’est faire confiance aux enfants. C’est résister à la tentation d’interrompre, de corriger, de valider trop vite. Pas facile pour un enseignant !
Au début, j’étais dérouté par certaines erreurs entendues, ou par des réponses très éloignées du sens de l’histoire. Mais pourquoi cet enfant parle d'un requin dans l'histoire ?!
Mais j’ai appris à les accueillir, sans rien laisser paraître, à les noter, et à revenir dessus plus tard. Souvent, ce sont les autres enfants qui finissent par faire évoluer la réponse d’un camarade, ou simplement en rejouant l'histoire avec des masques ou une maquette.
En résumé : L’enfant n’apprend pas en répondant aux questions de l’adulte, mais en entendant les réponses de ses pairs.
La pédagogie de l'écoute est transversale
Ce dispositif ne se limite pas à la compréhension d’histoires. Je trouve utile de l'utiliser pour tous les domaines :
- En mathématiques, pour expliquer un raisonnement ou une démarche,
- En activité physique, pour raconter une stratégie ou verbaliser une règle,
- En découverte du monde, pour formuler une hypothèse ou une observation.
- En écoute musicale, pour dire ce qui a été entendu, les sentiments provoqués par le morceau...
La pédagogie de l’écoute devient ainsi une démarche dans tous les apprentissages, notamment pour les élèves allophones, timides ou en difficulté langagière. Elle permet de développer non seulement la parole, mais aussi l’écoute active et la mémoire.
Adapter la pédagogie de l'écoute aux contraintes de la classe
Cette approche demande du temps. Elle bouscule nos rythmes habituels, et peut sembler exigeante. Le choix des textes doit être ajusté au vocabulaire et aux capacités d’évocation des enfants. Il m’est arrivé de constater des séances laborieuses, où l’histoire semblait trop complexe. Dans ces cas, j’ai appris à adapter : reformuler certains passages ou raccourcir la séance pour travailler sur le vocabulaire par exemple.
Mais avec de la régularité (2 fois par semaine pendant plusieurs semaines), les progrès sont réels. Et l’effet sur le climat de classe est souvent bluffant. Les élèves les plus réservés sont rassurés : la règle reste toujours la même. Ils osent prendre la parole avec plaisir.
Les séquences proposées restent coûteuses en temps avec 2 séances par semaine pendant 5 semaines environ. Or, si l'objectif est de voir les élèves les plus réservés prendre la parole, alors il est possible d'utiliser des histoires courtes. Dans le fond, l'objectif n'est pas tellement la compréhension d'histoire, mais d'oser prendre la parole. Des albums courts, des histoires très courtes peuvent donc être utilisées.
Pour aller plus loin
- Pédagogie de l’écoute et Machenka : récit d’une séquence avec un conte long.
- Compréhension : Le Monstre du Tableau : comment guider un échange structuré avec un album classique sur la rentrée riche.
- Comprendre des histoires de Noël
- Article de Delia Gobert (del_en_maternelle)
- Document de Nicolas Pinel
🔗 Vous pouvez commander les livres de Pierre Peroz sur Amazon :
📘 11 histoires pour une année de langage en petite section
📘 11 histoires pour une année de langage en moyenne section
📘 11 histoires pour une année de langage en grande section
Liens partenaires – prix identiques